C'ÉTAIT MIEUX AVANT OU C'ÉTAIT BIEN AVANT ?
Laurent Desjars
12/10/20245 min read


Depuis toujours, la communication événementielle s’appuie sur l’émotion pour permettre aux messages de marquer la mémoire de leurs publics. Je ne vous apprends rien : Un événement est avant tout destiné à rassembler autour d’une vision, d’objectifs précis, d’un destin commun et l’émotion, quelle qu’elle soit, a le pouvoir de fédérer parce qu’elle ne véhicule aucune idée, elle ne se discute pas et ne se contredit pas. Elle se partage, tout simplement. Elle réunit autour d’une expérience consensuelle et ouvre grande la porte à l’adhésion de toutes et de tous si elle est utilisée avec subtilité et intelligence.
Des dizaines d’agences ont revendiqué - et continuent de revendiquer, à juste titre, leur pouvoir de créer de l’émotion au même titre que l’on déclenche une étincelle qui va allumer un grand feu bénéfique. Mais de quelle manière s’y prend-t-on pour provoquer l’émotion auprès d’un public ? Comment fait-on pour que son authenticité puisse conquérir sans agacer ? Et quel sont, au final, les secrets de la mécanique qui créent les souvenirs ineffaçables, ces fameux souvenirs indélébiles dont tout le monde parle ?
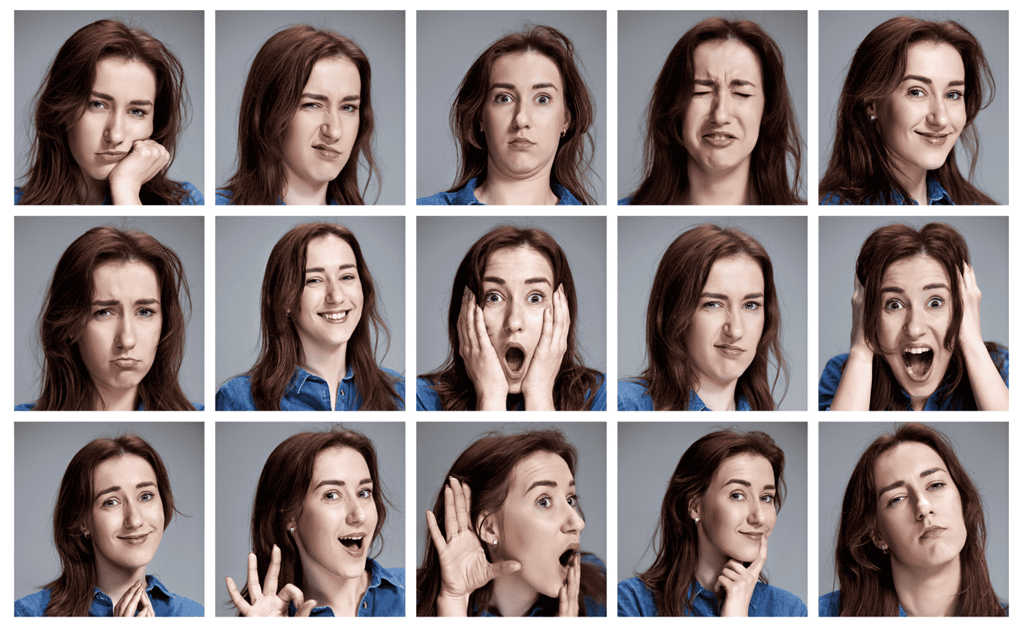
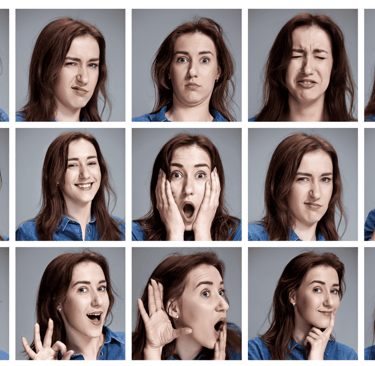
Tout d’abord, il faut bien distinguer les émotions négatives des émotions positives. Au risque de verser dans la caricature et une sociologie médiocre, les émotions positives sont des composantes importantes du sentiment de bien-être (Ce n’est pas moi qui l’affirme, ce sont des études sérieuses). Un événement va donc chercher à provoquer le bien-être de ses publics pour construire et déployer un discours et son train de messages.
Impossible de miser sur la tristesse, la peine, la douleur - vous imaginez ? - alors on préfère le rire, la légèreté, l’empathie, la générosité, la philanthropie, l’altruisme, le sensationnel, le partage, une certaine forme de dérision… (J’aurais pu mettre 6 petits points)
L’humour est l’un des stimuli sur lequel misent les concepteurs d’événements pour déclencher ce moment privilégié, ce moment fragile où tout le public se trouve connecté à une « expérience ». Bergson disait que le rire était le propre de l’Homme, mais l’humour est un art difficile à manipuler. Provoquer des rires est un exercice délicat, et d’autant plus délicat si le public est nombreux. Il faut beaucoup de talent pour déclencher un rire fédérateur – donc consensuel - et le talent est une notion très subjective. Le rire des uns n’est pas le rire des autres et lors d’un événement, ce n’est pas autour d’un artiste ou d’un humoriste que les collaborateurs se réunissent. C’est sans doute la raison pour laquelle l’humour est utilisé avec prudence. Ou tout simplement abandonné pour les mêmes raisons que je viens d’énoncer.


Moi qui aime les défis, j’ai souvent utilisé l’humour dans les événements que j’ai eu à concevoir. L’humour était une manière de se montrer original, de décaler les messages, de désamorcer des situations et des annonces délicates. J’ai évolué.
Avant, je ne croyais pas au passé, à la force des souvenirs d’enfance ou d’adolescence mais j’ai fini par changer d’avis. La nostalgie pouvait être une piste souriante. La nostalgie, ce n’est pas qu’une projection brutale dans le passé, c’est croquer à pleines dents dans des madeleines de Proust. Et les madeleines réussies, c’est un délice. On se souvient longtemps de leur goût de beurre et de leur chaleur délicate lorsqu’elles sortent du four. Serge Gainsbourg avait écrit une chanson, au début des années 80, qui s’appelle « La nostalgie, camarade ». Et cette chanson, même si les paroles sont tristes à mourir, est associée, dans mon inconscient, à de bons moments, à une époque rayonnante de ma vie. C’est ça la nostalgie. Camarade.


Dans sa chanson « Non, je n’ai rien oublié », Charles Aznavour chantait qu’il était doux de revenir aux sources du passé. Qui n’a pas résisté aux soirées « décennies » qui rappelaient les artistes des années 80, 90 ou 2000 ? Qui n’a pas résisté aux dress-codes datés, aux quizz et aux blind-test générationnels ? Qui n’a pas craqué pour toutes ces animations qui recyclent des camionnettes du passé pour en faire des bars ou des café guinguettes où l’on passe un bon moment, celui d’avant ou tout semblait plus agréable ?
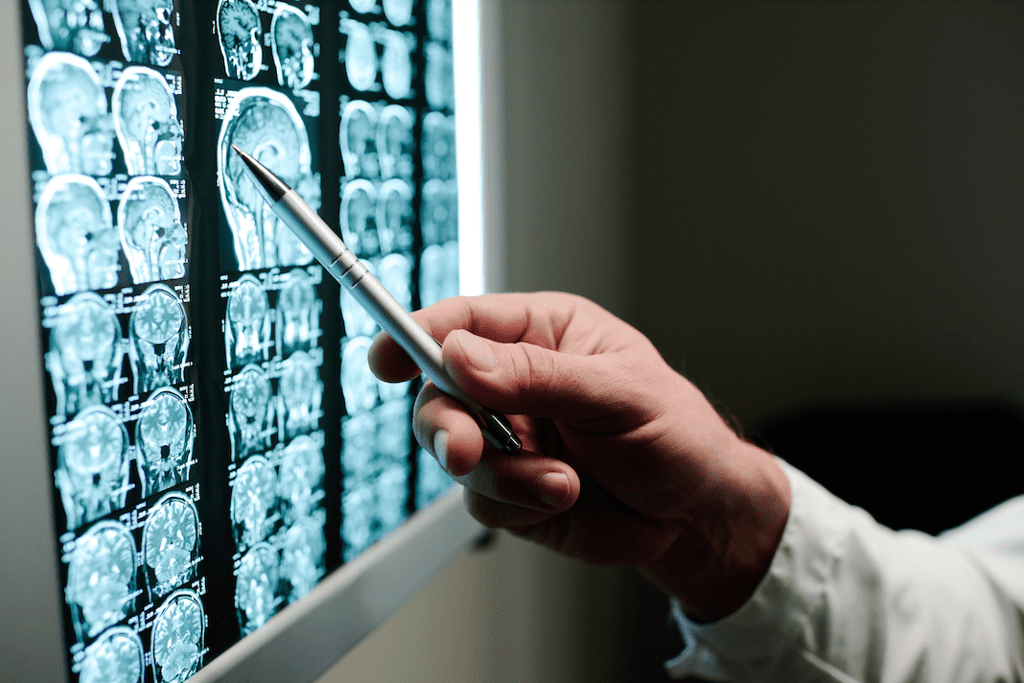
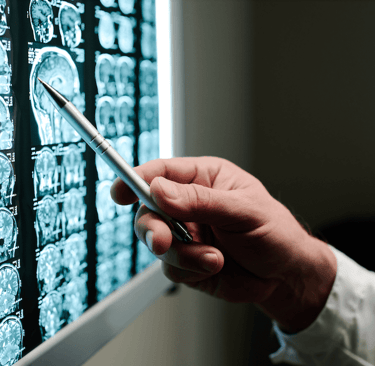
La nostalgie fait réagir le cerveau comme un arbre de Noël. Dans un article de Social Cognitive and Affective Neuroscience, les auteurs d’une étude associent les différentes zones cérébrales, celles qui clignotent comme des guirlandes, à quatre composantes psychologiques majeures : l’autoréflexion, la mémoire autobiographique, la régulation émotionnelle et le système de récompense.
La nostalgie serait donc une émotion particulièrement puissante ? Très puissante ? Au point de pouvoir créer des dépendances ?


J’ai en tête les boulodromes éphémères ou l’on peut boire des cocktails étranges, composés avec des breuvages sortis d’un lointain passé. J’ai en tête des polaroids, des 2CVs, des méharis. J’ai en tête le sourire de tous ceux qui ont chanté à tue-tête « L’Aventurier » sur une piste de danse, même ceux qui n’étaient pas nés au moment de la sortie de la chanson d’Indochine. C’est ça la nostalgie. C’était pas mieux avant, mais plutôt « Avant, c’était bien aussi ».


Pour répondre enfin à la question « comment fait-on pour faire du bien ? », je crois qu’il faut avant tout penser au public pour lequel on travaille, on se creuse la tête, on s’investit. Il faut penser à l’organisateur, penser à l’équipe du projet toute entière. Pour créer l’émotion sur un événement, il faut en avoir eu et partagé pendant toute la période de conception et de préparation. L’émotion, ça se travaille.
